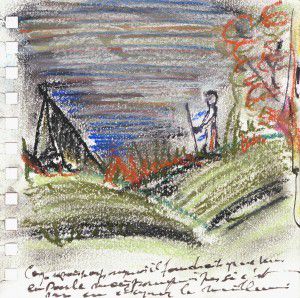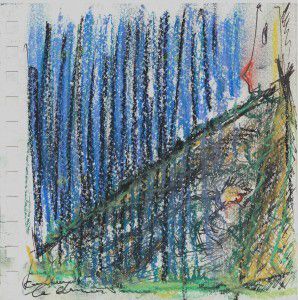Autobiographie rêvée
de Daniel Simon
Éditions Couleur Livres, collection Je, 2016.
ISBN 978-2-87003-652-5 / février 2016 - 90 pages / format 13*21 cm / 10 euros
L’Ogre des cabanes
suivi de
Les fleurs en papier crépon
On quitte son enfance d’un coup, comme ça, sans crier gare. On n’est plus éternel, on le sait, on laisse sa cabane derrière soi, on devient un homme parfois. L’Ogre est encore petit, il s’est enfui… dans la Grande Forêt. Les adultes parlent d’invasions, de Bombe, de nouvelle guerre. Ses parents attendent la fin du monde en faisant des réserves, toujours les mêmes : riz, sucre, allumettes, huile, boites de conserve…
L’Ogre a décidé de résister, il fuit cet univers de mort et de peur, il s’engage dans l’inconnu fabuleux où il va entrevoir ses vies futures dans le mystère et la solitude.
L’Ogre apprend enfin à vivre, il pourra mourir autant qu’il le voudra, dans les histoires qu’il peut maintenant dresser contre la peur originelle.
Daniel Simon, né à Charleroi en 1952, vit à Bruxelles. Ecrivain, éditeur, metteur en scène. Après divers métiers (formation, enseignement…) et voyages, il anime des Ateliers d’écriture et se consacre entièrement à l’écriture et à l’édition.
(Extrait, début)
C’était la nuit et je n’avais pas peur,
c’était le jour et j’étais un guerrier,
un enfant oublieux des terreurs anciennes,
certain d’aller si loin que je disparaîtrais
de la vue de tous dans des terres inconnues
que je voyais en moi, les années ont passé,
le monde a rétréci et le temps s’est joué
des exploits inachevés, des océans vaincus,
des féroces combats perdus bien plus souvent
que je n’avais prévu au fond de mon grenier
quand je lisais le soir mon destin héroïque
dans des livres d’images, j’ai ramené des voiles,
ralenti la cadence, changé de cap souvent,
me suis noyé encore, encore, au plus profond souvent,
j’ai ouvert tant de livres, vécu avec des hommes
chargés comme des mules des chagrins de toujours,
des joies libres comme l’air,
un matin, enfin, je me réveille enfin,
en moi, les autres sont entrés,
découvert le grenier et mes livres précieux,
cela ne pèse plus, le monde est plus léger,
le guerrier a vieilli, son armure a rouillé
et le visage nu, il va,
sur des sentiers nouveaux,
pas à pas, vers la grande forêt.
C’est ici que je reprends l’écriture de l’histoire de
l’Ogre. Je vais tenter de la raconter, comme celle
de toute une génération qui a eu le temps de se
perdre dans l’ennui et l’exploration en attendant la
fin du monde qui ne venait jamais.
Peut-être que c’est pour bientôt, il paraît, semble-t-il,
ça approche, comme tous les ans, c’est pour
bientôt.
Je ne pense pas que l’Ogre aie eu réellement peur.
Il a été blessé, sali, abîmé comme beaucoup d’enfants
mais ça ne l’inquiétait pas particulièrement.
C’était comme ça. Ça ne l’empêchait pas de mourir
sur place, c’était comme ça et on n’en parlait plus.
Entre deux tours de vis, deux serrements d’écrou, il
s’évadait dans ce qu’il pouvait, dans ce qu’il avait à
sa portée : parfois des livres, souvent rien, le vide,
rester fixe, regarder devant soi, respirer à peine
et laisser grandir toutes ces étranges histoires qui
l’étouffaient.
Pour suspendre le temps et se sentir à l’abri des
vacarmes, il ne fallait pas bouger d’un millimètre,
retenir sa respiration, la contrôler lentement, très
lentement, qu’on ne l’entende plus, aucun bruit
dans les oreilles, plus rien dans la tête, le vide, l’immobilité,
le souffle tendu, en apnée et ça dévalait
alors comme des chevaux dans le Grand Canyon.
Il aimait entrer dans cette bulle comme dans une
caverne où il faisait apparaître de formidables
monstres qu’il maîtrisait pas à pas. La ménagerie
s’est agrandie au fil du temps et la caverne a
rétréci.
Il s’est longtemps amusé de ces face-à-face. Il se
couchait, regardait le plafond, retenait sa respiration
un bref instant et d’un coup, il se reconnectait.
Tout émergeait, remontait jusqu’à sa tête,
ses jambes, ses bras, sa gorge, il était transporté,
le corps léger, libre, dans le temps et l’espace de
son choix.
Il plaçait ses personnages, construits à partir d’un
mot, d’une lumière, d’une couleur entrevue la
veille. Un chien aboyait, des enfants jouaient dans
la rue plus loin et il en faisait matière, tout s’imbriquait,
il laissait faire, ça s’associait librement
devant ses yeux et il n’en dormait pas souvent.
Le matin, tout était prêt, il écrivait dans son cahier
bleu ses histoires et ses questions sans réponse.
Des images ont persisté, des phrases, toujours
les mêmes, sont revenues lui grignoter l’oreille, il
s’éveillait en nage, calmait ses protagonistes, allait
faire pipi. Quand il se remettait au lit, ils étaient
dociles mais entrouverts comme des mains de
vieux sur la table.
Quand il a vieilli, il a écrit des morceaux de cette
aventure ancienne, il a essayé de ne pas oublier
la rage qui était en lui, et pourquoi cette rage
et aussi cette façon de ne pas croire et ne pas y
croire. Il pouvait aimer, oui, aimer de plus en plus
fort d’année en année, il aimait de plus en plus
intensément, se laissait emporter par cette nécessité
d’aimer. Plus que d’être aimé probablement.
C’était plus sûr.
Les adultes, les journaux, la télévision, ne parlaient
que de ça… D’invasions, de dangers, de la
Bombe. Mes parents disaient qu’ils avaient peur
pour moi mais je ne les croyais pas, je voyais que
c’était pour eux, cette peur, d’abord pour eux,
qu’ils l’avaient fabriquée pour se protéger du
monde ou quelque chose comme ça, pour s’obliger
à supporter et à se distraire des…
J’ai donc aujourd’hui repris les textes laissés par
l’Ogre et les ai relus. Je vais tenter ici de mettre un
peu d’ordre dans tout ce qu’il a griffonné avant,
pendant et après son aventure. J’ai souvent le sentiment
de glisser vers le grand lieu de la disparition,
et les textes que je laisse ici et là à la disposition
des lecteurs sont probablement une façon
d’enfoncer mes ongles dans la paroi et de ralentir
la glissade finale.
L’Ogre a appris lors de son grand voyage tout ce
qu’il devrait connaître pour survivre à l’aigreur,
aux tromperies, aux abandons et aux coups bas.
Il a appris à contrer ce à quoi est confronté chacun.
Il a glané dans ces épreuves de la joie et
une sorte de légèreté qui le corsetaient quand sa
colère fulminait.
Ses colères naissaient de ce sentiment d’injustice
et de mensonge qu’il avait vite repérés dans
le monde des adultes. Il les dévoilait quels que
soient leur déguisements, emphases, litotes… Une
parole, une intonation, un regard et il débusquait
le mépris, entrevoyait la veulerie à l’instant.
Il était encore petit, l’Ogre. Mais il grandirait
vite. Trop vite. Dans sa famille, on disait de lui :
“Comme il grandit vite, comme il est grand !”.
Il quitterait sa taille d’enfant, il allait perdre ce
qu’il aimait le plus, regarder le monde du bas vers
le haut, en admiration, devant le scintillement du
ciel.
Je sais, je me souviens aujourd’hui de ce qui a
fabriqué l’Ogre.
L’Ogre sait ce qu’il fait, il croit encore, il n’est pas
marqué par l’usage et le poids du passé. Il peut se
lancer, aller droit, marcher, envisager. L’Ogre est
en train de naître.
Les nuages sont hauts et c’est dans cette lande
sans contour qu’il veut aller. La langue qu’il parle,
est-ce déjà la sienne ou celle qu’il veut conqué-
rir au long de ce récit ? On ne sait pas encore.
On comprendra peut-être plus tard. Dans tous les
cas, il part pour survivre. En ce moment, il ne sait
encore ce qu’il fait, il joue à un jeu dangereux.
Il joue, il ne faudra pas oublier qu’il joue. A quelle
roulette joue-t-il ? C’est une autre histoire, mais il
joue sans cesse, pour ne pas ressembler à ce qu’il
semble déjà condamné.
Au début, dans la maison, il y avait la joie, puis
les cris, puis le silence. Ce silence que les enfants
souvent boivent jusqu’à la lie quand ils ne sont
pas cloués contre leurs fines parois de solitude.
De ces bruits sans pardon, il pourrait dire beaucoup
mais il part pour ne plus les entendre. Ce
sont rugissements, gémissements, râles, cris per-
çants, extinctions, aboiements souvent.
Il aime traîner en lui, s’ennuyer jusqu’au vertige,
s’arrêter sur des impressions volatiles, les retenir
en les parcourant en tous sens, avant qu’elles ne
s’échappent et se dispersent dans le monde. Il
s’emploie souvent à rester immobile, devant une
chose, n’importe laquelle, une chose qu’il regarde
longuement et qui devient belle, parfois, unique.
Il regarde ce qui l’entoure, il tente de garder ce
qui échappe de lui.
Il en avait entendu des récits, des histoires de
guerre, de Jaunes, de Rouges qui allaient débarquer
et nous enfermer ou nous tuer, et la Bombe
nous protégerait mais tout le monde serait frappé
alors on pensait à cette terrible seconde, on se
voyait dans la lumière finale et on se serrait les
mains.
Les parents, la télévision, la radio en parlaient, les
journaux, à l’école, tout le monde, on faisait des
provisions…
On surprenait encore des choses comme ça, entre
deux portes, l’air de rien, des femmes qui craquaient,
des hommes qui criaient ou pleuraient,
ça dépend. Parlaient bas, rameutaient de sales
histoires quand ils avaient bu mais nous, on les
entendait… La guerre n’était pas loin, on en parlait
presque tous les jours. Comme cette histoire,
d’une tante luxembourgeoise, mille autres…
“… Je vais vous le dire, c’était pas comme vous le
dites, pas entièrement. C’était mieux, comment on
dit ? Mieux que mal… Pire… C’est ça… Pire. Moi
j’étais à la ferme, Helmut était pas là, Helmut était
loin et moi je livrais le lait, les œufs, je livrais tout
ce que je pouvais livrer pour garder la ferme, ne
pas la perdre, être capable de la tenir si Helmut
était revenu comme ça du jour au lendemain. Mais
je pensais toujours qu’il reviendrait pas, mais ça je
pouvais pas le penser vraiment, ça venait comme
çà, quand j’arrêtais de travailler, le soir souvent,
ou le matin, quand je me réveillais et que le lit
était vide de lui. Je me suis jamais habituée à ça,
le matin quand il faut se lever et qu’on parle à ses
pantoufles comme à un chien allongé au pied du
lit, un bon chien avec ses oreilles pendantes, un
chien qui dit rien mais qui reste près de vous, là
au pied, je parlais à mes savates et je me disais
que j’allais devenir folle un jour, alors je me lavais
et je m’y mettais dur, la ferme, la traite, les œufs,
les tournées, les bonjour, les ça va, les oui, oui,
tout ça, sans Helmut, c’est dur, alors je me suis dit
que peut-être que si je faisais comme si de rien
n’était ça irait mieux, et je me suis mise à rire, aller
mieux, ça me faisait rire, Helmut avait été engagé
de force, il était parti au front, en Flandres, chez
les Français, enfin contre, nous on était contre et
Helmut il savait pas contre qui en fait il devait tirer,
des Français on en connaissait, on avait un cousin
qui avait marié une Française, de Strasbourg, et
on les aimait bien, on les avait vus trois fois, mais
chaque fois c’était bien, comment ils nous avaient
reçu, vous pouvez pas savoir, une grande table,
plus longue que vous pouvez imaginer, elle dépassait
de la salle-à-manger, ils pouvaient la dresser
qu’en été, d’à cause qu’ils devaient ouvrir la porte
de la cour pour la laisser sortir, elle commençait
dans la cour cette table et terminait dans le jardin,
de l’autre côté de la maison, une table comme un
bateau, je sais pas moi, jamais vu de pareille, et à
cette table on était toute la famille, mon Helmut
avait dix ans de moins et moi aussi du fait, et les
cousins fêtaient leur premier, un beau gamin, mais
il est resté muet, je sais pas pourquoi, il a jamais
vraiment parlé, comme si c’était pas nécessaire,
il comprenait tout mais il parlait pas, il regardait,
faisait des choses sans les dire, c’était pas nécessaire
pour lui de parler, bref, mon Helmut il est
en France maintenant et il m’écrit que ça va, que
c’est dur mais que ça va, il m’a dit qu’il allait aussi
bien que le cheval, qu’il galopait et qu’il se sentait
jeune et fort, mais on n’a pas de cheval, et je
sais qu’il me dit ça pour la censure, on n’a pas de
cheval, c’est Helmut qui fait le cheval, en Flandres
contre les Français…”
Une autre fois, ils parlaient des Russes, de Sé-
bastopol, de Cuba, du siège de Stalingrad, de la
retraite de Moscou, d’Auschwitz, de Breendonk,
d’Hiroshima, de la Chine, de la Corée, de… Des
millions de morts.
Chacun le soir avait son histoire à la bouche, chacun
essayait d’effrayer l’autre alors le père nous
avait demandé de nous taire. Du Grand-père aux
enfants, plus un mot là-dessus.
Ça n’arrêtait pas, ça pesait et on aimait ça, les copains
et moi. C’était bizarre, on se disait qu’on
allait enfin la connaître la guerre, mais en mieux.
Qu’on ne serait pas toujours la bouche ouverte
à écouter celle des autres et que nous aussi on
pourrait dire : “C’était…”.
On aurait aimé que ça tombe sur la maison des
voisins pour mieux voir ce que ça ferait en vrai.
Ils se mirent tous à acheter des masses de conserve,
de sucre, de sel, de pâtes de riz, de Pilchards, ces
écœurants poissons à la sauce tomate, toutes ces
choses qu’ils pensaient suffisantes pour se garantir
une retraite dans les caves en attendant la Bombe.
On en voyait les ravages à la télévision, certains
tombaient malades de peur, d’angoisse.
La folie de la Bombe était là.
L’Ogre écoutait en silence. Il avait tenté deux ou
trois fois de poser des questions mais les enfants
n’avaient pas encore droit aux questions, l’époque
n’était pas aux questions. La guerre, la troisième
allait éclater et chacun s’y préparait plus ou moins
consciencieusement.
L’Ogre prit alors sa décision. Il devait partir, vivre
avant le grand blanc final.
Il partira donc et quittera sa maison. Il prendra
un sac avec quelques affaires et marchera vers la
forêt. C’est dans la forêt que les monstres trouvent
aussi leur place et il avait appris à les dompter. Il
ne lui restait que ce refuge pour supporter la vie
qui allait être la sienne : un enfant trop grand dans
un monde trop petit. Il avait découvert le minuscule
et le médiocre dans les parades des adultes,
dans les façons de ne pas être présents et toujours
ailleurs à faire des choses qu’ils n’aimaient
pas faire. Il allait devenir un faiseur, comme les
grands, une sorte de pantin maladroit avec sa déjà
grosse voix et son corps encombrant.
On lui disait, tu seras ceci et cela et il détestait tout
autant ceci que cela. Mais il était encore petit et la
peur prenait toute la place en lui, rien ne pourrait
le protéger, trop d’amour était nécessaire et il n’a
pas trouvé autour de lui ce qu’il espérait recevoir.
Les enfants, petits et grands, rêvent de mourir
souvent, déjà frappés par le grand consentement
auquel on leur demande d’adhérer
Dessins au crayon gras qui ont accompagné la publication au fur et à mesure de l’écriture d’une partie de ce texte sur mon ancien blog : http://traverse.unblog.fr/
Je continue d’écrire sur un nouveau Blog : http://je-suis-un-lieu-commun-journal-de-daniel-simon.com/
Quelques pages : http://www.couleurlivres.be/images/autobio-qqpages.pdf
Communiqué de presse et commande : http://www.couleurlivres.be/images/PI-autobio-bd.pdf
"Ma lecture de l'Ogre et des Fleurs en papier : beau, c'est beau, réjouissant, émouvant et bruissant d'enfance et cela remue dans la tête et le corps. Merci Daniel, puis, pour moi lectrice "kinaka" lire et entendre ses phrases, c'était court et même si c'était juste ce qu'il fallait, quand même : encore encore !

/image%2F1157765%2F20211024%2Fob_59d1ec_13886934-10153729070497927-23850975933.jpg)